TL;DR:
🛡️ L’hébergement souverain, c’est, entre autres, s’assurer que vos données sont hébergées au Québec ou au Canada, par une entreprise locale non soumise à des lois étrangères (comme le Cloud Act américain).
⚖️ Pourquoi c’est important ?
- Protéger la vie privée et éviter la surveillance étrangère.
- Se conformer à la Loi 25, qui limite le transfert de données personnelles hors Québec.
- Réduire les risques juridiques, économiques et techniques.
- Renforcer la confiance des clients et la résilience des organisations.
🧩 Comment faire ?
- Utiliser des hébergeurs locaux souverains.
- Opter pour des solutions open source et auto-hébergées (Nextcloud, Mattermost, etc.).
- Former son équipe et exiger la transparence sur la gestion des données.
👥 Pour qui ?
PME, OBNL, citoyens : tout le monde est concerné. La souveraineté numérique est un levier concret pour protéger nos droits, nos données et notre autonomie.
La souveraineté numérique désigne la capacité pour un État, une organisation ou un citoyen de garder le contrôle de ses infrastructures et données numériques. En pratique, cela signifie s’assurer que nos données, nos logiciels et nos systèmes d’information sont soumis uniquement aux lois et juridictions locales, sans ingérence étrangère. On parle d’hébergement souverain lorsque les données sont hébergées sur des serveurs situés dans le pays (par exemple au Québec ou au Canada), par une entreprise locale soumise aux lois locales. L’objectif est que les données bénéficient de la protection juridique nationale et échappent aux lois étrangères.
Attention aux idées reçues : ce n’est pas parce que vos données sont physiquement stockées sur le sol canadien qu’elles sont forcément à l’abri des lois d’un autre pays.
Par exemple, si une entreprise américaine comme AWS ou Microsoft Azure héberge vos données à Montréal, ces données pourraient malgré tout être accessibles aux autorités américaines en vertu de lois extraterritoriales comme le CLOUD Act. Autrement dit, la localisation physique ne garantit pas à elle seule la souveraineté : il faut aussi regarder qui contrôle l’infrastructure. Un véritable cloud souverain implique donc non seulement un hébergement local, mais aussi un opérateur local, soumis exclusivement aux lois canadiennes.
En résumé, opter pour un hébergement souverain revient à conserver la maîtrise de ses données. Cela englobe : où elles sont stockées, qui y a accès, et quelles lois s’y appliquent. Par exemple, un organisme québécois qui héberge son site web et sa base de données chez un fournisseur québécois indépendant s’assure que ces données sont régies par les lois du Québec et du Canada (comme la Loi 25 ou la LPRPDE fédérale), et non par des lois étrangères potentiellement moins protectrices.
Un enjeu géopolitique et économique dans le contexte actuel
Nous vivons dans un contexte géopolitique où les données sont devenues un atout stratégique majeur – certains parlent même des données comme du “nouveau pétrole”. Les grandes puissances l’ont bien compris, et chacune veut défendre ses intérêts numériques. Cela se manifeste de plusieurs façons :

- Loi extraterritoriales et surveillance étrangère : Des pays comme les États-Unis ont adopté des lois qui leur permettent d’accéder à des données partout dans le monde, dès lors que ces données sont sous la garde d’entreprises de leur juridiction. Le CLOUD Act américain en est un exemple frappant : il autorise le gouvernement américain à exiger l’accès à vos données même si elles sont hébergées au Canada, tant qu’elles sont stockées chez un fournisseur cloud soumis au droit américain. En clair, si une PME québécoise utilise un service cloud géré par une entreprise américaine, ses données pourraient être transmises aux autorités des États-Unis sans que le gouvernement canadien ne puisse s’y opposer. Cela soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de surveillance des données par des entités étrangères.
- Tensions commerciales et indépendance technologique : Les grandes entreprises du numérique (souvent appelées GAFAM pour Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft) dominent l’écosystème technologique mondial. Cette situation crée une dépendance des autres pays à l’égard de technologies et services étrangers. En cas de tensions diplomatiques ou de guerre commerciale, cette dépendance peut devenir un risque : imaginez par exemple qu’une plateforme essentielle décide de couper ses services dans certains pays pour se conformer à des sanctions ou pressions politiques. Les organisations locales seraient fortement impactées. Assurer sa souveraineté numérique, c’est réduire cette vulnérabilité et éviter que des décisions politiques étrangères ne puissent paralyser nos activités économiques ou nos communications.
- Protection de la vie privée et valeurs locales : Chaque pays ou région a ses propres lois et valeurs en matière de protection des renseignements personnels. Au Québec par exemple, la culture accorde une grande importance à la vie privée et à la particularité linguistique et culturelle. Héberger localement permet de mieux respecter ces spécificités – par exemple, s’assurer que les interfaces logicielles sont en français, ou que les pratiques de gestion des données correspondent aux attentes locales. À l’inverse, confier toutes ses données à des entreprises étrangères, c’est risquer qu’elles soient gérées selon des règles et une éthique différentes, parfois moins strictes en termes de confidentialité. La souveraineté numérique vise aussi à préserver nos valeurs et notre identité numériques locales.
- Initiatives internationales : Conscients de ces enjeux, plusieurs gouvernements lancent des initiatives pour reprendre le contrôle. En Europe, on parle beaucoup de « cloud souverain » et de projets comme Gaia-X, un réseau de cloud européen fédéré pour garantir que les données des entreprises européennes restent sous juridiction européenne. De même, la France a tenté de développer ses propres solutions cloud nationales pour contrer l’hégémonie américaine. Au Canada, la question se pose également : on voit émerger des fournisseurs de cloud canadiens se présentant comme des alternatives souveraines, et le gouvernement impose de plus en plus que les données sensibles (par exemple les données gouvernementales ou de santé) soient stockées sur le sol canadien. Cet élan vers la souveraineté numérique s’explique par la volonté de protéger la sécurité nationale, la vie privée des citoyens et la compétitivité économique face aux géants étrangers.
En somme, l’hébergement souverain n’est pas un caprice local, c’est un impératif stratégique dans le monde d’aujourd’hui. Le contrôle des données et des infrastructures numériques est devenu un enjeu de pouvoir et d’indépendance au même titre que le contrôle de l’énergie ou des ressources naturelles. Pour le Québec et le Canada, assurer une certaine autonomie numérique, c’est protéger notre démocratie, notre économie et nos citoyens dans un contexte mondial incertain.
Pourquoi est-ce important pour les PME et les OBNL ?
On pourrait penser que ces préoccupations ne concernent que les gouvernements ou les grandes entreprises, mais les petites et moyennes entreprises (PME) et les organismes à but non lucratif (OBNL) sont tout autant concernés. Voici pourquoi la souveraineté numérique importe aussi pour eux :

- Protection des données sensibles : Les PME et OBNL collectent et traitent souvent des données sensibles : listes de clients ou de membres, informations financières, données personnelles d’employés ou de bénéficiaires, propriété intellectuelle, etc. Si ces informations tombaient entre de mauvaises mains (concurrents, États étrangers, cybercriminels), les conséquences pourraient être graves. En adoptant un hébergement souverain, une entreprise s’assure que ses données restent protégées par les lois locales strictes en matière de confidentialité, et ne sont pas exposées à des juridictions étrangères potentiellement plus permissives. Par exemple, une OBNL qui gère une base de données de santé mentale voudra éviter qu’elle soit hébergée sur un cloud hors-Canada où les normes de confidentialité sont moins strictes.
- Conformité légale et réglementaire : La Loi 25 au Québec et les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels s’appliquent à la plupart des entreprises et organisations (nous détaillerons ces lois plus loin). Ces règlements obligent les organismes à protéger les données des citoyens et à encadrer les transferts de données vers l’extérieur. Une PME qui utilise n’importe quel service en ligne doit se demander : où vont mes données ? Si elles sortent du pays, est-ce fait dans le respect de la loi ? Opter pour des solutions d’hébergement locales facilite grandement la conformité. Au contraire, si vos données sont stockées à l’étranger, vous devez souvent effectuer des évaluations rigoureuses et obtenir des garanties que le pays destinataire offre une protection équivalente – ce qui peut être complexe. La Loi 25 impose notamment une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant de communiquer des renseignements personnels hors Québec. Ne pas s’y conformer expose l’entreprise à des sanctions juridiques et financières.
- Réduction des risques extraterritoriaux : On l’a vu, des entités étrangères pourraient légalement accéder aux données d’une PME si celles-ci sont hébergées par un fournisseur soumis à des lois extraterritoriales. Pour une entreprise québécoise, cela peut représenter un risque d’espionnage économique (par exemple, ses secrets industriels pourraient être saisis dans le cadre d’une enquête étrangère) ou de perte de contrôle en cas de litige hors de nos frontières. En maintenant ses données sous souveraineté canadienne, on réduit ce risque légal : aucune autorité étrangère ne peut venir saisir légalement vos données sans passer par les canaux juridiques canadiens. Cela garantit aussi aux clients et partenaires que leurs informations ne seront pas divulguées à des gouvernements étrangers sans raison légitime.
- Indépendance stratégique et continuité d’activité : Pour une PME ou OBNL, dépendre entièrement d’un fournisseur technologique unique peut être dangereux. Que se passe-t-il si ce fournisseur décide un jour de changer ses conditions, d’augmenter drastiquement ses prix, ou s’il subit une panne majeure ou une interdiction de fournir ses services (par exemple suite à une sanction) ? En utilisant des solutions souveraines, les organisations gagnent en autonomie stratégique : elles peuvent choisir des partenaires locaux plus flexibles, voire héberger en interne certaines applications critiques. Cela améliore leur résilience – la continuité des opérations a moins de chances d’être compromise par des décisions prises à l’étranger ou des problèmes hors de leur contrôle. En cas de crise politique ou économique internationale, une PME souveraine numériquement sera mieux outillée pour continuer à servir ses clients.
- Image de confiance et respect des valeurs : De plus en plus, le public se soucie de la protection de ses données personnelles. Pour un OBNL œuvrant avec des populations vulnérables ou pour une PME cherchant à gagner la confiance de sa clientèle, pouvoir afficher que “vos données sont hébergées ici, chez nous, et protégées par nos lois” est un atout non négligeable. C’est un gage de sérieux et d’éthique. À l’inverse, une organisation qui ferait transiter des informations sensibles de Québécois vers des serveurs situés à l’étranger sans transparence pourrait susciter de la méfiance ou des critiques. Dans un contexte où la responsabilité sociale des entreprises prend de l’importance, la souveraineté numérique peut faire partie des bonnes pratiques de gouvernance à mettre de l’avant.
En résumé, pour les PME et OBNL du Québec et du Canada, assurer un hébergement souverain de leurs données, c’est protéger leurs actifs numériques, se conformer à la loi, minimiser les risques de fuites ou d’ingérence, et démontrer leur engagement envers la confidentialité et la sécurité. Tout cela contribue à une meilleure gouvernance et à la pérennité de leur mission.
L’importance pour les individus et la vie privée des citoyens
Les citoyens, en tant qu’individus, sont également au cœur de la souveraineté numérique. Après tout, ce sont leurs données personnelles qui sont en jeu : nom, adresse, historique de navigation, photos, messages, données de santé, etc.. Pourquoi Monsieur et Madame Tout-le-Monde au Québec devraient-ils se soucier de l’hébergement souverain ?
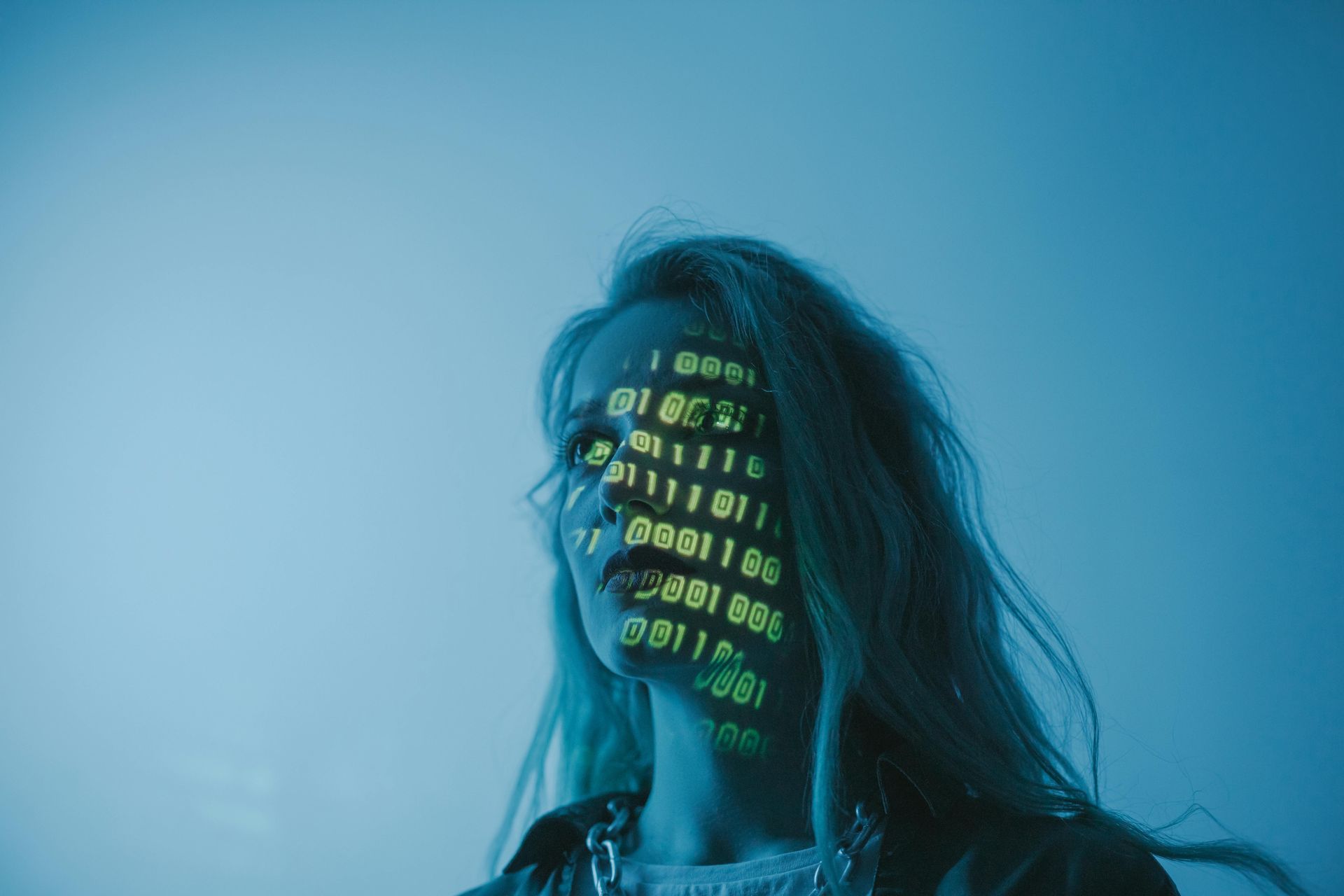
- Protection de la vie privée : Lorsque vous utilisez une application mobile, un réseau social ou un service en ligne, vos informations personnelles peuvent être stockées n’importe où sur la planète. Si ces données sont hébergées à l’étranger, elles tombent sous la juridiction du pays hôte. Par exemple, vos messages envoyés via une messagerie américaine peuvent, en théorie, être demandés par les autorités américaines. Le pays en question n’offre pas toujours les mêmes garanties de vie privée que le Canada ou le Québec. En gardant vos données au pays, vous bénéficiez des protections légales locales, comme la Loi 25 qui renforce vos droits et encadre strictement l’utilisation de vos renseignements personnels. Autrement dit, la souveraineté numérique renforce votre capacité à contrôler qui a le droit de voir et d’utiliser vos informations personnelles.
- Recours et droits plus efficaces : Si vos données sont hébergées localement, en cas de problème (violation de données, usage abusif, etc.), il vous sera plus facile d’exercer vos droits. Au Québec, la Loi 25 vous donne par exemple le droit d’accès à vos informations, le droit de les rectifier, de retirer votre consentement à leur utilisation, voire de demander leur suppression dans certains cas. Essayez d’exercer ces droits si vos données résident dans un pays étranger : le processus sera beaucoup plus complexe, voire impossible si l’entreprise se réfugie derrière des lois étrangères moins favorables aux consommateurs. La souveraineté numérique garantit que vos droits suivent vos données – vous restez maître de votre information personnelle.
- Réduction des risques de surveillance et d’abus : L’actualité a montré à plusieurs reprises que des programmes de surveillance de masse existaient, et que certaines entreprises technologiques n’hésitent pas à exploiter les données des utilisateurs à des fins commerciales discutables. Un hébergement souverain n’élimine pas tous les risques, mais limite la portée de ces abus potentiels. Si vos données restent au Canada, elles ne seront pas accessibles par un gouvernement étranger sans passer par le système de justice canadien (ce qui offre des protections, comme la nécessité d’avoir des motifs valables, des mandats, etc.). De plus, des lois locales comme la Loi 25 exigent un consentement clair pour la collecte et l’utilisation de vos données. Vous avez donc plus de contrôle sur ce que les organisations font de vos informations, ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs.
- Maintien d’un écosystème numérique local : Au-delà de la vie privée, il y a aussi une dimension culturelle et communautaire. En choisissant des services numériques locaux ou respectueux de la souveraineté, les citoyens encouragent le développement d’un écosystème québécois et canadien du numérique. Cela veut dire plus d’outils en français, conçus par des gens qui comprennent le contexte local, nos besoins et nos valeurs. Par exemple, un service québécois saura qu’il doit se conformer à la Charte de la langue française pour son interface, ou sera sensible aux enjeux locaux. Soutenir ces alternatives, c’est contribuer à un internet plus diversifié et moins dominé par quelques multinationales.
Que peut faire un individu pour promouvoir sa souveraineté numérique ? Il n’est pas nécessaire d’être expert en informatique pour adopter des réflexes simples qui renforcent votre contrôle. Voici quelques conseils concrets :
- Se poser la question de l’hébergement : À chaque fois que vous confiez des données à un service (achat en ligne, inscription sur un site, utilisation d’une application), n’hésitez pas à vous demander « Où sont hébergées mes données ? ». Les entreprises mentionnent souvent dans leurs politiques de confidentialité si les informations sont stockées localement ou transférées à l’étranger. Cette prise de conscience est un premier pas essentiel.
- Privilégier les fournisseurs locaux ou éthiques : Si vous avez le choix, optez pour des services qui hébergent les données au Québec ou au Canada. Par exemple, certaines messageries courriel, solutions de stockage en ligne ou applications de bureautique locales offrent des garanties de souveraineté. De même, des moteurs de recherche ou réseaux sociaux alternatifs mettent de l’avant le respect de la vie privée et le stockage local des données. Bien sûr, ils peuvent être moins connus que les géants américains, mais leur utilisation soutient l’économie numérique locale et protège mieux vos renseignements.
- Lire (au moins en partie) les politiques de confidentialité : Ce n’est pas l’activité la plus divertissante, mais jeter un coup d’œil aux sections qui parlent de stockage des données et de transferts internationaux peut vous éclairer. Vous saurez ainsi si le service envoie vos données dans un autre pays. Beaucoup de sites ont maintenant une section dédiée à la résidence des données du fait de réglementations comme la Loi 25 ou le RGPD en Europe.
- Exercez vos droits : En tant que résident du Québec, vous disposez de droits concrets sur vos informations personnelles grâce à la Loi 25. N’hésitez pas à les utiliser. Par exemple, vous pouvez demander à une entreprise de vous fournir toutes les données qu’elle possède sur vous, ou de corriger une information erronée. Si vous n’êtes pas à l’aise pour le faire vous-même, sachez qu’il existe des organismes et des modèles de lettres pour vous aider. En exerçant vos droits, vous affirmez votre souveraineté individuelle sur vos données.
- Restez informé et vigilant : Les enjeux de la protection des données évoluent rapidement. De nouvelles lois apparaissent, de nouveaux services aussi. Intéressez-vous aux actualités sur la vie privée, suivez des guides de bonnes pratiques (il en existe de très accessibles en ligne), et partagez ces connaissances avec vos proches. Plus la population sera sensibilisée, plus les entreprises et gouvernements auront intérêt à respecter la souveraineté numérique. Un citoyen averti en vaut deux : en demandant par exemple à votre fournisseur internet ou à votre application mobile des comptes sur l’endroit où sont vos données, vous faites avancer la cause.
En définitive, la souveraineté des données touche directement la protection de votre vie privée et le contrôle que vous exercez sur vos informations personnelles. Chaque individu a un rôle à jouer pour devenir un citoyen numérique averti, qui ne clique pas sur “J’accepte” sans réfléchir aux conséquences. Il ne s’agit pas de sombrer dans la paranoïa, mais d’adopter une approche éclairée et responsable de nos outils numériques du quotidien.
Le cadre légal : Loi 25 et exigences en matière de protection des données
Au Québec et au Canada, la prise de conscience autour de la souveraineté numérique s’est traduite par un renforcement du cadre juridique ces dernières années. La Loi 25, adoptée par le Québec, en est le parfait exemple. Officiellement intitulée Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, cette loi a actualisé et renforcé les règles afin de mieux protéger la vie privée à l’ère numérique.

Quelques points saillants de la Loi 25 et du cadre légal environnant :
- Consentement et transparence accrus : La Loi 25 oblige les organisations (publiques et privées) à obtenir un consentement éclairé des individus pour la collecte et l’utilisation de leurs renseignements personnels. Fini les cases pré-cochées en petits caractères ! Pour les entreprises, cela a impliqué de revoir les bannières de cookies sur les sites web, d’expliquer clairement à quoi serviront les données collectées, etc. L’esprit est de créer une culture de protection de la vie privée dans les pratiques d’affaires.
- Obligations lors de transferts hors Québec : C’est un aspect directement lié à la souveraineté numérique. La Loi 25 impose aux entreprises de prendre des mesures particulières avant d’héberger ou d’envoyer des données personnelles à l’extérieur du Québec. Concrètement, une entreprise doit faire une évaluation des risques et s’assurer que les renseignements bénéficieront d’une protection “équivalente” dans l’autre juridiction. Si ce n’est pas le cas, le transfert pourrait être interdit. Cela incite fortement les organisations à garder les données au Canada ou à ne travailler qu’avec des partenaires offrant des garanties solides. Ce n’est pas sans rappeler le principe du RGPD européen qui restreint l’envoi de données des Européens vers des pays non adéquats. Pour une PME québécoise, cela signifie par exemple qu’elle doit réfléchir à deux fois avant de stocker ses bases de données clients sur un serveur aux États-Unis. Savoir où vos données sont hébergées est crucial pour déterminer quel cadre légal s’applique et quels sont vos recours en cas de problème.
- Nouveaux droits pour les citoyens : En plus des droits d’accès et de rectification qui existaient déjà, la Loi 25 introduit des droits inspirés du modèle européen, comme le droit à la portabilité des données (pouvoir récupérer ses données dans un format transférable) et des obligations de transparence lorsqu’il y a prise de décision automatisée par des algorithmes. Tous ces éléments renforcent le pouvoir des individus sur leurs données. Or, ce pouvoir ne peut s’exercer pleinement que si les données restent à portée du cadre juridique local. D’où l’importance, encore une fois, de savoir où résident les données. Un droit théorique ne sert à rien si les données sont dans un territoire où on ne peut l’appliquer.
- Sanctions sévères et incitations : Le non-respect de ces règles peut entraîner des amendes significatives. La Commission d’accès à l’information du Québec, chargée de faire appliquer la Loi 25, peut infliger des pénalités pouvant aller jusqu’à plusieurs millions de dollars ou un pourcentage du chiffre d’affaires annuel, en fonction de la gravité. Par ailleurs, à partir de 2024, les entreprises non conformes à la Loi 25 pourraient être exclues de certains contrats publics. Cela motive les organisations à se mettre en règle rapidement. Le gouvernement a même offert des programmes de formation et des subventions pour aider surtout les PME à s’ajuster. L’objectif est clair : faire de la protection des données une norme, pas une exception. Et cette protection passe en grande partie par une localisation et une gestion plus rigoureuses des données (d’où notre sujet de l’hébergement souverain).
- Cadre fédéral et futur : En parallèle, au niveau canadien, la loi fédérale existante (LPRPDE – Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, aussi appelée PIPEDA en anglais) encadre la gestion des informations personnelles dans le secteur privé. Le Canada prépare également une réforme de ses lois via le projet de Loi C-27, qui inclura la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (une sorte de “RGPD canadien”) et une loi sur l’intelligence artificielle. L’accent est mis sur la transparence, le consentement et la responsabilité des entreprises. On parle même d’une future Charte canadienne du numérique. Tout cela va dans le sens d’un renforcement de la souveraineté numérique nationale : le Canada veut s’assurer que les données de ses citoyens sont traitées selon ses normes, peu importe où se trouve le prestataire. Il sera de plus en plus difficile pour une entreprise de justifier que des données partent à l’étranger sans protection.
En somme, le cadre légal québécois et canadien évolue pour soutenir la souveraineté numérique. Des lois comme la Loi 25 au Québec garantissent que nos données demeurent sous la protection de nos lois et imposent des limites aux transferts non sécurisés à l’extérieur. Pour les organisations, c’est à la fois un défi (il faut se conformer, adapter ses systèmes) et une opportunité de revoir leur stratégie numérique en privilégiant des solutions locales et sécuritaires. Pour les citoyens, c’est un filet de sécurité supplémentaire qui s’ajoute à la vigilance personnelle : la loi vient outiller les individus et fixer des gardes-fous, bien que la vigilance individuelle reste primordiale.
Au-delà de la localisation : l'importance du « backbone » et de l’indépendance technologique
Nous l’avons souligné plus haut : la souveraineté numérique ne se résume pas à la localisation géographique des serveurs. Il faut également considérer le « backbone » de l’infrastructure, c’est-à-dire l’ensemble de la chaîne technologique qui supporte vos services numériques. Cela inclut les propriétaires des centres de données, les fournisseurs de services cloud, le matériel utilisé, les logiciels déployés, et même les chemins empruntés par les données sur le réseau.

Pourquoi est-ce aussi important que la localisation elle-même ?
- Juridiction du fournisseur et chaîne de sous-traitance : Imaginons que vous hébergiez vos données chez un prestataire basé à Montréal. Très bien. Mais si ce prestataire est en réalité une filiale d’une multinationale étrangère, ou s’il sous-traite certaines opérations à l’étranger, vos données peuvent tout de même être à risque. Par exemple, de nombreuses entreprises utilisent des services d’infonuagique de géants américains (AWS, Microsoft, Google) qui ont des centres de données au Canada. Cependant, ces entités restent régies par le droit du pays d’origine (droit américain pour AWS/Microsoft/Google). Cela signifie que, en cas d’injonction légale aux États-Unis, la filiale canadienne devra obtempérer et fournir l’accès aux données, même si celles-ci résident physiquement au Canada. Le backbone juridique compte autant que l’emplacement du disque dur : qui détient la clé du serveur ? Qui peut y accéder à distance ? Qui administre la plateforme ? Si la réponse n’est pas “une organisation de chez nous, uniquement soumise à nos lois”, alors la souveraineté n’est pas complète.
- Contrôle des accès et du personnel : La souveraineté inclut la gestion des accès aux données. Si vos données sont hébergées par une entreprise locale mais que son équipe technique ou son support est externalisé à l’étranger, des personnes en dehors de notre juridiction pourraient potentiellement accéder aux systèmes. Certes, les entreprises sérieuses cloisonnent les accès, chiffrent les données et limitent ce que peut faire un employé, mais humainement il y a un enjeu de confiance et de contrôle. Un hébergeur souverain idéal, c’est un hébergeur où toutes les opérations critiques sont effectuées localement par du personnel de confiance soumis aux mêmes obligations légales (de confidentialité, etc.). Cela réduit les risques de fuites ou d’abus internes difficiles à poursuivre légalement parce qu’ils se produisent hors de nos frontières.
- Infrastructure réseau et matérielle : Le chemin qu’empruntent vos données sur Internet peut aussi avoir des implications. Par exemple, au Canada, beaucoup de trafic Internet transite par les États-Unis (en raison de la géographie des grands câbles et dorsales). Cela signifie que même un courriel envoyé de Montréal à Québec peut, selon les circonstances, passer par des routeurs situés aux États-Unis. Théoriquement, cela l’expose à la surveillance étrangère durant le transit. Des efforts sont faits pour développer des points d’échange internet locaux et minimiser ces détours, justement dans une optique de souveraineté technologique. De même, la question du matériel se pose : utiliser massivement du matériel étranger (routeurs, serveurs) peut comporter des risques d’espionnage s’il y a des portes dérobées (backdoors) installées par des fabricants peu scrupuleux. On a vu ces dernières années des pays bannir certains équipements 5G fournis par des entreprises étrangères pour des raisons de sécurité nationale. Cela relève de la souveraineté numérique également : être capable de faire confiance à son infrastructure de base, ou développer des alternatives locales quand c’est possible.
- Logiciels libres et indépendance vis-à-vis des éditeurs : Un autre pan du backbone technologique, ce sont les logiciels que nous utilisons. Beaucoup de solutions propriétaires (systèmes d’exploitation, bases de données, suites bureautiques, etc.) sont éditées par de grands groupes souvent étrangers. Opter pour des logiciels libres et open source est un moyen de renforcer sa souveraineté numérique. En effet, un logiciel libre offre plus de transparence (le code peut être audité), et il peut être hébergé n’importe où sans dépendre d’un fournisseur particulier. Les institutions publiques en France, par exemple, encouragent l’utilisation de logiciels libres pour réduire la dépendance aux solutions propriétaires étrangères. Pour une PME ou un OBNL, cela peut signifier choisir un système de gestion de contenu open source pour son site web au lieu d’une plateforme propriétaire en SaaS, ou utiliser une suite bureautique libre plutôt que de stocker tous ses documents sur des outils cloud dont on ne maîtrise pas les rouages. L’open source apporte de la souveraineté logicielle, c’est-à-dire la maîtrise des outils eux-mêmes, en plus des données. Bien sûr, tout le monde n’a pas les moyens de vérifier le code source ou d’héberger son propre service, mais le simple fait de choisir un outil open source souvent garantit qu’on peut changer d’hébergeur plus facilement, ou conserver ses données dans des formats standards.
En clair, la souveraineté numérique nécessite une approche holistique : il faut penser écosystème complet. Localiser les données au Canada est une condition nécessaire, mais non suffisante. Il faut aussi s’assurer que le contexte d’hébergement (propriétaire du cloud, personnel, matériel, logiciels) est aligné avec nos impératifs de souveraineté. C’est pourquoi lorsque l’on parle de “cloud souverain”, on insiste sur le fait qu’il doit être opéré par une entité de droit local et soumis aux lois locales exclusivement. Dès qu’un maillon de la chaîne relève d’une autorité extérieure, une brèche dans la souveraineté apparaît.
Heureusement, de plus en plus d’initiatives cherchent à combler ces brèches : développement de clouds nationaux, encouragement des solutions open source, et adoption de politiques publiques pour utiliser des technologies locales quand c’est possible. Pour les organisations, cela passe par exemple par la préférence à l’achat local de solutions numériques et une réflexion sur la dépendance aux fournisseurs externes. Pour les individus, cela se traduit par la préférence à des applications plus respectueuses, et le soutien à un internet ouvert et diversifié.
Solutions pour un hébergement souverain : alternatives décentralisées et open source
Face aux enjeux décrits, on pourrait se sentir un peu dépassé. Mais la bonne nouvelle, c’est que des solutions existent pour concrétiser l’hébergement souverain et reprendre le contrôle. Des alternatives – souvent open source, décentralisées et locales – sont disponibles dans la plupart des domaines numériques.

Faisons un tour d’horizon de ce qui peut être fait :
Choisir des fournisseurs d’hébergement locaux et indépendants
Plutôt que de se tourner automatiquement vers les géants du cloud bien connus, il est possible d’opter pour des fournisseurs d’hébergement canadiens. Au Québec, il existe des centres de données et des entreprises spécialisées en cloud qui mettent de l’avant la souveraineté. Leur promesse : vos données restent au pays, gérées par une entreprise d’ici, et ne seront jamais transférées à l’étranger sans votre consentement. Certains ont même des certifications ou des partenariats garantissant cette souveraineté (par ex. le programme “Sovereign Cloud” de VMware compte un partenaire canadien à 100% de propriété locale).
En Europe, on recense plusieurs clouds souverains nationaux ou régionaux (OVHcloud en France, Hetzner en Allemagne, etc.) comme alternatives aux services type AWS. De la même façon, on voit apparaître au Canada des offres comparables. Il y a aussi des initiatives à but non lucratif ou coopératif : par exemple, en France, le collectif CHATONS (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) regroupe des hébergeurs éthiques fournissant des services en ligne respectueux de la vie privée. On pourrait imaginer l’équivalent ici – certaines coopératives ou OBNL commencent d’ailleurs à offrir des services numériques mutualisés pour leurs membres.
Avantage d’un fournisseur local : la relation de confiance est plus directe. Vous pouvez souvent parler à un responsable, connaître l’emplacement précis de vos données, voire visiter le centre de données si c’est une grande préoccupation. Les contrats peuvent spécifier clairement que aucun transfert international n’aura lieu, et en cas de problème, vous pouvez vous adresser à la justice locale. De plus, soutenir ces fournisseurs contribue à l’essor de l’industrie tech locale et crée de l’emploi chez nous.
Mettre en place des solutions open source et auto-hébergées
Grâce à l’open source, une organisation peut envisager d’héberger elle-même certains services critiques, ou de le faire héberger par un partenaire de confiance, sans passer par les plateformes propriétaires des géants. Il existe aujourd’hui des solutions libres et clés en main pour quasiment tous les besoins :
- Stockage de fichiers et collaboration : Au lieu d’utiliser Google Drive ou Dropbox, on peut déployer un outil comme Nextcloud, qui est une suite cloud libre. Nextcloud permet le partage de fichiers, la synchronisation, l’édition collaborative de documents, la gestion d’un agenda et des contacts, la messagerie instantanée et la visioconférence. C’est une plateforme complète qui offre en plus un chiffrement de bout en bout et une gestion fine des permissions. Atout majeur : la maîtrise totale des données – Nextcloud peut être hébergé sur votre propre serveur ou par un fournisseur local, et vous conservez à tout moment la propriété de vos fichiers. De plus, étant open source, Nextcloud est conforme aux normes de protection (RGPD en Europe, donc tout à fait aligné avec Loi 25). Plusieurs PME québécoises ont par exemple adopté Nextcloud pour remplacer des services cloud étrangers, avec succès.
- Messagerie et communications d’équipe : Au lieu de Slack (propriété d’une entreprise américaine) ou Microsoft Teams, il existe des alternatives open source telles que Rocket.Chat ou Mattermost. Ces solutions permettent le clavardage en groupe, le partage de fichiers, les appels audio/vidéo, etc. Leurs points forts sont souvent la décentralisation (elles peuvent être hébergées sur vos propres serveurs), l’interopérabilité et la transparence du code. Rocket.Chat, par exemple, souligne la souveraineté des données qu’il offre : vous décidez où résident vos échanges, nul besoin de les stocker dans le cloud d’une tierce partie. Certaines organisations gouvernementales ou entreprises sensibles (secteur santé, etc.) utilisent Mattermost ou Rocket.Chat justement pour garder leurs communications internes à l’abri de serveurs étrangers.
- Courriel et bureautique en ligne : Beaucoup d’organisations utilisent la suite Google Workspace (Gmail, Docs, etc.) ou Office 365. Là aussi, des options souveraines existent. Pour l’e-mail, on peut très bien faire héberger son courriel chez un fournisseur canadien respectueux de la vie privée (il en existe plusieurs qui chiffrent les emails de bout en bout et garantissent le stockage local). Pour la bureautique en ligne, des solutions comme OnlyOffice ou Collabora Online couplées à Nextcloud permettent d’éditer à plusieurs des documents directement dans un navigateur, de manière similaire à Google Docs, tout en hébergeant le tout sur un serveur sous votre contrôle. OnlyOffice, par exemple, est open source et peut être installé sur site ; il offre une compatibilité avec les formats Microsoft Office courants. L’intégration Nextcloud + OnlyOffice est une combinaison populaire pour qui cherche une alternative complète à Google Drive/Docs.
- Sites web et gestion de contenu : Plutôt que de s’en remettre à des plateformes « tout-en-un » propriétaires pour son site (par ex. un constructeur de site dont on ignore où les données sont stockées), on peut s’appuyer sur des CMS open source bien établis (WordPress, Drupal, etc.) hébergés chez un prestataire local. On conserve ainsi la maîtrise de la base de données des utilisateurs, des contenus, etc. Là encore, le code ouvert permet de vérifier l’absence de porte dérobée et d’avoir une communauté qui améliore la sécurité en continu.
- Réseaux sociaux alternatifs : Pour les individus désireux de souveraineté, le mouvement “Fediverse” (univers fédéré) offre des réseaux sociaux décentralisés. Des plateformes comme Mastodon (alternative à Twitter) ou Pixelfed (alternative à Instagram) sont composées de serveurs indépendants (souvent gérés localement ou par des communautés) qui communiquent entre eux. Vous pouvez choisir un serveur québécois pour créer votre compte Mastodon, et vos données de profils, posts, etc., resteront sur ce serveur plutôt que de partir sur les serveurs de Meta ou X Corp. C’est une façon de reprendre contrôle tout en restant connecté avec le monde. Bien sûr, ces réseaux sont encore émergents comparés aux géants, mais ils gagnent en popularité et démontrent qu’un internet différent, plus décentralisé, est possible.
- Applications spécifiques : Pour presque chaque application propriétaire, on trouve un équivalent libre et souverain. Besoin d’un outil de gestion de projet en ligne ? OpenProject est une solution open source avec hébergement local, utilisée en Europe et conforme aux règles de souveraineté européenne. Besoin d’un outil de visioconférence ? Jitsi Meet permet de faire des réunions vidéo sans compte, en hébergeant le serveur soi-même ou via des instances respectueuses. Besoin d’un stockage de mots de passe en ligne ? Des outils comme Bitwarden (open source) peuvent être auto-hébergés… La liste est longue.
Bien entendu, recourir à ces solutions nécessite une certaine expertise technique ou l’accompagnement d’un prestataire compétent. Une PME peut ne pas avoir un grand service informatique pour installer et maintenir Nextcloud ou Mattermost. Cependant, il existe des intégrateurs locaux ou des sociétés de services prêtes à le faire pour vous. Les coûts associés sont à mettre en balance avec les bénéfices en sécurité et indépendance. De plus, nombre de ces solutions libres sont modulaires : on peut commencer petit (par exemple, migrer le partage de fichiers vers un Nextcloud hébergé localement, tout en gardant d’autres services chez un fournisseur externe) puis étendre progressivement à d’autres outils au fur et à mesure que l’on monte en compétences ou que l’on gagne confiance.
Un point encourageant : ces alternatives open source s’améliorent constamment et sont soutenues par de larges communautés. Les avantages qu’on peut en tirer rejoignent d’ailleurs les objectifs de la souveraineté numérique :
- Accès au code source : gage de transparence et de confiance (on sait ce que fait réellement l’outil).
- Multi-serveurs et décentralisation : pas de point de contrôle unique, donc pas de mainmise d’une seule entité sur vos données.
- Hébergement souverain garanti : vous choisissez où déployer (chez vous ou chez un hébergeur local de confiance).
- Engagement éthique : la plupart de ces projets s’engagent à ne pas monétiser abusivement les données et à respecter la vie privée.
- Communauté et entraide : en cas de faille de sécurité, des milliers de développeurs à travers le monde peuvent contribuer à corriger rapidement, ce qui souvent fait des logiciels libres des outils très robustes.
Il faut également être conscient des défis : l’interface de certains outils libres peut être moins léchée que celle des produits commerciaux, la formation des utilisateurs est nécessaire pour changer les habitudes, et toutes les solutions libres ne sont pas encore au niveau de leurs équivalents Big Tech sur certains plans (par ex. l’ergonomie, ou l’intégration poussée de certaines fonctionnalités). Cependant, ces écarts se réduisent avec le temps, et l’investissement peut en valoir la peine sur le long terme, pour gagner en autonomie.
Enfin, soulignons que le gouvernement lui-même peut jouer un rôle de soutien. En France, l’État a lancé des programmes pour aider les PME à adopter des outils numériques souverains (via l’initiative France Num, etc.). Au Canada, on pourrait imaginer des subventions ou des labels pour encourager l’hébergement souverain. En attendant, la pression légale (Loi 25 et compagnie) agit déjà comme un moteur du changement.
Étude de cas : comparaison entre deux scénarios d’hébergement
Pour concrétiser tout cela, examinons deux cas de figure illustrant la différence entre un hébergement non souverain et un hébergement souverain. Imaginons une petite entreprise fictive, ABC inc. basée au Québec, qui gère un site web de commerce électronique et une base de données de clients, incluant des renseignements personnels (noms, courriels, adresses, historique d’achats).

Cas 1 : Hébergement non souverain chez un géant étranger
ABC inc. décide par facilité de tout héberger chez “GlobalCloud”, un fournisseur bien connu (fictif pour l’exemple) basé aux États-Unis, qui possède des centres de données partout dans le monde. Lors de l’inscription, ABC inc. choisit l’option “région Canada” pour héberger ses serveurs, pensant que cela suffit à garantir que les données restent ici. Le service est bon marché et les performances sont excellentes, le site tourne bien.
Mais en arrière-plan : le contrat de GlobalCloud stipule qu’en cas d’obligation légale, les données peuvent être transmises aux autorités compétentes du pays où la société mère est établie. En clair, si un tribunal américain le demande, GlobalCloud devra remettre les données de ABC inc. (même hébergées au Canada) aux autorités américaines, en vertu du Patriot Act/CLOUD Act. ABC inc. n’en sera peut-être même pas informée (certaines ordonnances de sécurité nationale viennent avec des clauses de silence).
De plus, GlobalCloud a du personnel d’administration système réparti dans plusieurs pays. Régulièrement, des ingénieurs aux États-Unis ou en Inde accèdent aux machines (y compris celles de ABC inc.) pour la maintenance. ABC inc. n’a pas de regard sur ces opérations ; elle fait confiance au prestataire.
Un jour, ABC inc. apprend que, par un incident de sécurité, des données clients ont été consultées par une tierce partie. Difficile de savoir s’il s’agit d’un hacker ou d’un accès gouvernemental. L’entreprise doit annoncer la fuite aux clients et à la Commission d’accès à l’information (obligation légale de notification en cas de violation de confidentialité, prévue par la Loi 25). En enquêtant, ABC inc. réalise que ses données transitaient régulièrement via des serveurs aux États-Unis pour des sauvegardes redondantes, et que c’est possiblement là que l’accès non autorisé a eu lieu.
Par ailleurs, ABC inc. se rend compte qu’en stockant des données personnelles de Québécois sur un service étranger, elle aurait dû faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et s’assurer que GlobalCloud offrait des protections équivalentes à la Loi 25 – ce qu’elle n’a pas formellement fait. Elle risque donc des sanctions. Son erreur vient en partie d’une méconnaissance : la localisation “Canada” dans l’interface de GlobalCloud lui a donné un faux sentiment de sécurité, alors que le backbone du service n’était pas souverain.
Conséquences pour ABC inc. dans ce scénario : une perte de confiance de certains clients informés de la brèche, un potentiel problème légal avec le régulateur, et un stress certain quant à la confidentialité de ses données stratégiques (doit-elle craindre que ses chiffres de ventes soient analysés par des entités étrangères ?). Certes, elle a bénéficié de la commodité d’un grand cloud au début, mais elle commence à en voir les limites et risques cachés.
Cas 2 : Hébergement souverain chez un fournisseur local + solutions open source
Dans le second scénario, ABC inc. a choisi dès le départ (ou après l’incident précédent, pour se rattraper) de miser sur la souveraineté numérique. Elle contacte “CloudQuébec” (fournisseur fictif), une entreprise d’infonuagique basée à Québec, certifiée 100% québécoise. CloudQuébec garantit par contrat que toutes les données restent sur ses serveurs au Québec, qu’aucun employé ou sous-traitant étranger n’aura accès aux données sans autorisation, et qu’en cas de demande d’accès par une autorité non canadienne, ils en informeront le client et contesteront la demande si elle n’est pas conforme aux lois canadiennes.
ABC inc. migre donc son site et sa base de données chez CloudQuébec. L’entreprise en profite pour remplacer quelques outils internes : elle installe par exemple un Nextcloud hébergé chez CloudQuébec pour stocker ses fichiers et partager des documents avec ses partenaires, remplaçant du même coup son ancien usage de Google Drive. Elle utilise également un service de courriel local (fourni par CloudQuébec ou un autre partenaire) au lieu de Gmail, de sorte que les communications email de l’entreprise restent au pays.
Le déploiement nécessite un peu de travail initial et des frais légèrement supérieurs à ceux de GlobalCloud, mais ABC inc. gagne en contrepartie plusieurs bénéfices :
- Conformité légale sans casse-tête : Puisque les données de clients sont désormais hébergées localement, ABC inc. peut beaucoup plus facilement démontrer sa conformité à la Loi 25. Elle n’a plus de transfert international à évaluer. Dans sa politique de confidentialité, elle indique fièrement “Vos données sont stockées au Québec et ne sont jamais transmises hors de nos frontières sans votre consentement explicite”. C’est un bon point aux yeux de la Commission d’accès à l’information et des clients soucieux de leur vie privée.
- Sécurité renforcée et support de proximité : CloudQuébec offre un support francophone, dans le même fuseau horaire. En cas de problème, ABC inc. obtient de l’aide rapidement, sans barrière culturelle ou linguistique. Par ailleurs, CloudQuébec suit les normes de sécurité québécoises, et étant une petite structure, elle est transparente sur ses procédures. ABC inc. a pu visiter le centre de données (ou au moins recevoir un rapport détaillé) et se rassurer sur les contrôles d’accès physiques, les sauvegardes, etc. Elle sait que ses données ne seront pas copiées dans un autre pays sans qu’elle le sache.
- Aucun accès étranger sans passer par les lois canadiennes : Si un jour une autorité quelconque souhaite accéder aux données de ABC inc. (disons, hypothétiquement, une enquête mais qui devrait impliquer des données de ABC inc.), elle devra passer par la justice canadienne et CloudQuébec se conformera uniquement aux ordres émanant d’un tribunal canadien compétent. ABC inc. aura la possibilité de défendre la confidentialité de ses informations devant nos juges. C’est un niveau de protection juridique bien supérieur au scénario 1, où ABC inc. n’aurait même pas été informée d’une requête étrangère.
- Valorisation auprès des clients : Sur son site web et ses communications, ABC inc. souligne désormais son engagement en faveur de la protection des données. Elle explique, en termes simples, à ses utilisateurs que leurs informations restent au pays, protégées par les lois du Québec et du Canada. Ce discours rassure la clientèle, notamment les plus sensibilisés (parmi eux peut-être des organismes publics, des clients d’Europe soumis au RGPD qui apprécient de savoir que ABC inc. prend ces sujets au sérieux, etc.). ABC inc. transforme donc la souveraineté numérique en avantage concurrentiel et en argument marketing positif.
- Expérience acquise et contrôle : En gérant son Nextcloud et en travaillant avec un cloud local, ABC inc. a développé de nouvelles compétences internes ou via son prestataire. L’entreprise comprend mieux son infrastructure et peut l’adapter à ses besoins spécifiques (chose plus difficile sur une plateforme inflexible comme GlobalCloud). Par exemple, elle a pu demander à CloudQuébec d’adapter la configuration pour améliorer les temps de réponse sur son site aux heures de pointe locales, ce qu’un géant à distance n’aurait peut-être pas fait. Ce contrôle accru lui donne plus de latitude pour innover, ajouter de nouvelles fonctionnalités sans dépendre des limitations imposées par un fournisseur étranger.
En fin de compte, le scénario 2 montre qu’avec un peu de planification et les bons partenaires, il est tout à fait possible pour une PME d’évoluer dans un environnement numérique souverain sans sacrifier la modernité ou l’efficacité. ABC inc. peut toujours vendre en ligne, communiquer et collaborer tout aussi bien qu’avant – mais elle le fait désormais d’une manière qui aligne la technologie avec ses valeurs et ses obligations juridiques. Ce faisant, elle contribue à bâtir un écosystème plus robuste localement.
Conclusion : vers une autonomie numérique bénéfique pour tous
L’hébergement souverain n’est pas simplement une lubie patriotique ou un repli sur soi. C’est au contraire une démarche proactive pour assurer la sécurité, la confidentialité et l’indépendance de nos activités numériques dans un monde hyperconnecté.

Pour les PME et OBNL du Québec et du Canada, embrasser la souveraineté numérique signifie renforcer leur gouvernance, réduire des risques souvent invisibles, et gagner la confiance de ceux avec qui elles interagissent. Pour les individus, c’est la promesse d’un meilleur contrôle de leur vie privée, et la garantie que leurs droits (droit à la vie privée, droit à l’oubli, etc.) peuvent s’exercer pleinement sur leurs données.
Nous avons vu que la souveraineté numérique englobe un ensemble de mesures : localisation des données sous juridiction locale, maîtrise du backbone (infrastructure et outils), recours aux logiciels libres et aux solutions décentralisées, sans oublier le soutien d’un cadre légal fort comme la Loi 25 qui vient cimenter ces bonnes pratiques. Chacun de ces aspects se renforce mutuellement : une loi stricte pousse à adopter des solutions souveraines, et plus il y aura de solutions locales, plus il sera facile de se conformer aux lois et de convaincre d’autres de faire de même.
Bien sûr, atteindre une souveraineté numérique complète est un cheminement. Il faut du temps pour développer des alternatives locales compétitives, pour former les entreprises et le grand public à de nouveaux outils, et pour ajuster les politiques. Mais chaque pas compte. En 2025, on peut dire que la prise de conscience est là : l’État québécois modernise ses lois, des entreprises d’ici innovent pour offrir du cloud souverain, et de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer un Internet plus respectueux des utilisateurs et des souverainetés nationales.
En adoptant une approche pédagogique et informée – comme nous avons essayé de le faire dans cet article – on réalise que la souveraineté numérique n’est pas qu’une affaire de spécialistes. C’est l’affaire de tous. PME, OBNL, citoyens, gouvernement : chacun a un rôle pour bâtir un environnement numérique où nos données ne nous échappent pas. Il s’agit en quelque sorte de “reprendre le pouvoir” sur nos outils technologiques, un pouvoir qu’on avait parfois abandonné par facilité ou méconnaissance.
Pour conclure, retenons ceci : choisir l’hébergement souverain et les solutions ouvertes, c’est investir dans une technologie au service de l’humain et de la communauté. C’est soutenir l’idée que le progrès numérique peut rimer avec respect de la vie privée, avec autonomie et avec diversité des acteurs. Le Québec et le Canada ont toutes les compétences et le talent nécessaires pour exceller dans ce domaine. En faisant le pas vers la souveraineté numérique, nous créons un futur où le numérique renforce notre souveraineté (et non la dilue), où chaque petite entreprise ou individu peut se sentir en sécurité dans le monde en ligne, tout comme dans le monde physique.
La souveraineté numérique, en fin de compte, c’est la liberté de rester maîtres de notre destin numérique, et c’est essentiel dans le contexte géopolitique actuel. Adoptons-la et adaptons-nous, pour un numérique plus sûr, plus éthique et plus nôtre.